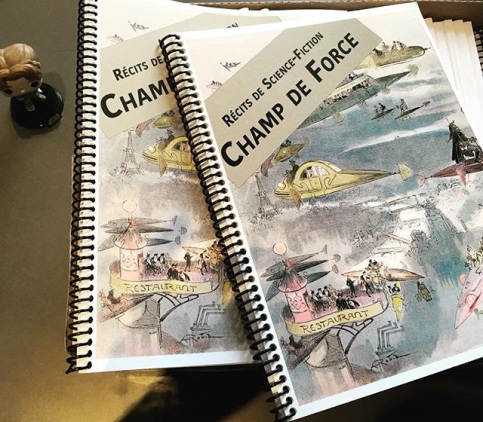Also, I am tired of all the dead.
They refuse to listen,
so leave them alone.
Take your foot out of the graveyard,
they are busy being dead.
Anne Sexton, « A Curse against Elegies »
Après mon doctorat et surtout après ma soutenance de thèse, il était très clair dans ma tête que je n’avais plus qu’un seul projet : apprendre à désapprendre. Sortir l’université de moi. Je me suis rendu compte que comme universitaire j’avais passé douze ans de ma vie d’étudiante à laisser entrer dans ma tête la voix de tout un chacun. J’avais rapidement découvert que quand on prépare une demande de bourse doctorale ou postdoctorale, par exemple, il faut écouter tous les conseils possibles, poser des questions et faire lire ses textes. Je crois que c’est le chemin le plus sûr pour obtenir l’aide financière demandée. C’est ce que j’ai fait. Ce faisant, j’ai laissé des tonnes d’interlocuteurs (pas toujours les plus recommandables!) entrer dans ma tête. En écrivant, je pensais constamment à leurs avis, j’essayais d’anticiper le regard qu’ils auraient sur les nouvelles versions de mes textes. Ça m’a sans doute bien servie, j’ai eu les bourses convoitées, mais ça m’a aussi détruite à bien des égards. Je suis, entre autres, devenue viscéralement dégoûtée par la littérature. Au début de mon stage postdoctoral, j’avais beaucoup de mal à lire, surtout aucune envie d’écrire. Je me suis guérie en consacrant mes journées au dessin. C’était ma sortie hors du discours, ma porte de secours hors de ce monde d’argumentaires et de confrontations stériles.
Peu à peu, j’ai recommencé à lire. L’écriture est venue bien après. Je ne lisais plus comme avant. Je me suis mise à retrouver mon regard d’enfant et d’adolescente sur les textes, des yeux curieux, ouverts, amoureux… J’avais ce regard d’autrefois auquel s’ajoutaient la connaissance et l’expérience acquises pendant quatorze années passées à l’université. C’était alors évident que bien des formes de discours sur la littérature ne m’intéressaient plus. Je n’avais pas envie de dénicher les soi-disant futurs chefs-d’oeuvre, pas d’intérêt pour les débats idiots dans lequel on tente de déterminer quel écrivain est plus grandiose qu’un autre. Je m’éloignais aussi de bien des thèmes chéris des universitaires… Récemment, j’ai reçu une demande pour évaluer un article pour une revue scientifique. J’étais amusée par l’idée, j’ai lu avec un grand plaisir l’article. Ça m’a permis aussi de mesurer plus que jamais mon écart avec la logique universitaire. Je sentais ma distance avec la rhétorique et le jargon de l’institution. J’ai redécouvert avec un certain plaisir la langue de l’université, parce qu’elle ne me concerne plus. Elle ne me fait pas de mal. J’ai re-choisi la littérature. J’y reviens parce que je ne ferai plus de compromis. Cette position plus ferme et plus assurée est paradoxalement accueillante et souple. Écrire sans compromis veut dire m’ouvrir au monde. J’ai re-choisi la littérature, parce qu’elle m’a sauvée la vie un milliard de fois, parce qu’elle me rend heureuse, parce qu’elle me donne le goût d’aimer, de rire, de jouer.
Poursuivre la lecture